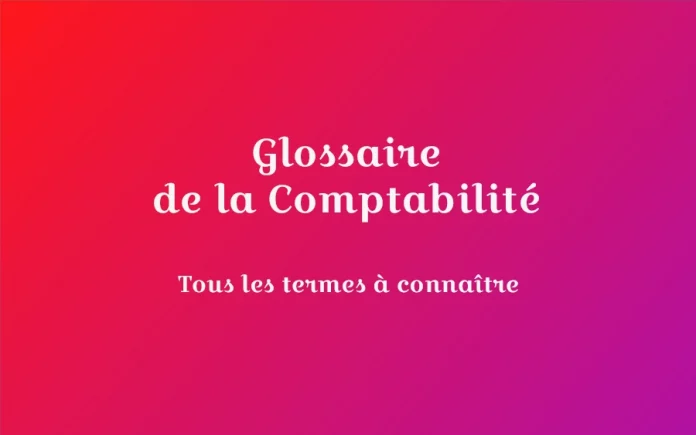Consultez notre glossaire comptabilité pour connaitre tous les termes techniques, acronymes, abréviations et expressions utilisés dans le métier de la comptabilité . Ce lexique comprend toutes les définitions des termes clés (d’Achats à TVA) ainsi que des exemples pour améliorer votre vocabulaire ainsi que votre compréhension de ce domaine.
La comptabilité est une discipline structurée par des règles, des normes et des obligations légales strictes. Dans ce cadre, la maîtrise du vocabulaire comptable est essentielle pour assurer la fiabilité des enregistrements, la clarté des états financiers et la conformité aux exigences fiscales. Chaque terme utilisé possède une signification précise qui conditionne l’interprétation des chiffres et la qualité des décisions économiques qui en découlent.
Des notions telles que actif, passif, bilan, compte de résultat, amortissement, provision, produits, charges, journal, grand livre ou plan comptable constituent la base du langage professionnel utilisé au quotidien par les comptables, les experts-comptables, les contrôleurs de gestion et les auditeurs. Une mauvaise compréhension ou une utilisation imprécise de ces termes peut entraîner des erreurs d’enregistrement, des déclarations erronées ou des décisions inappropriées.
Ce vocabulaire facilite également le dialogue entre les différents services de l’entreprise (direction, finance, fiscalité, juridique) et les tiers externes (administration fiscale, commissaires aux comptes, partenaires financiers). Il permet de produire des documents lisibles, structurés et auditables, essentiels à la transparence financière et à la crédibilité de l’entreprise.
Achats : Les achats désignent les acquisitions de biens ou services nécessaires à l’activité de l’entreprise. Ils concernent aussi bien les matières premières que les prestations externes et sont consommés ou transformés pour générer du chiffre d’affaires. Ils figurent parmi les charges d’exploitation et leur maîtrise est essentielle pour la rentabilité.
Actif : L’actif représente tout ce que possède une entreprise et qui est susceptible de générer des avantages économiques futurs. Il inclut les immobilisations (corporelles, incorporelles, financières), les créances, les stocks et la trésorerie. Un actif doit être identifiable, contrôlé par l’entreprise et valorisable de manière fiable dans les comptes.
Actif circulant : Cet actif à court terme comprend les éléments destinés à être utilisés, consommés ou transformés dans le cycle normal d’exploitation, comme les stocks, les créances clients ou la trésorerie. Sa rotation rapide permet à l’entreprise de financer son activité et d’assurer la liquidité nécessaire au fonctionnement quotidien.
Actif courant : Un actif est qualifié de courant s’il est censé être vendu, utilisé ou converti en trésorerie dans l’année suivant sa comptabilisation. Cela comprend notamment les créances clients, les stocks et les liquidités. Il s’oppose à l’actif non courant destiné à rester durablement dans le patrimoine.
Actif d’impôt différé : Il s’agit d’un avantage fiscal futur inscrit à l’actif, généralement issu de décalages entre les règles comptables et fiscales. Il représente une économie d’impôt probable dans les années à venir et reflète des pertes reportables ou des déductions fiscales à venir inscrites de manière anticipée.
Actif économique : L’actif économique correspond aux ressources productives d’une entreprise, mobilisées pour générer de la valeur. Il regroupe les immobilisations et le besoin en fonds de roulement. Cet actif est financé par les capitaux propres et les dettes financières, et sert souvent de base à l’évaluation de la performance.
Actif immobilisé : Les actifs immobilisés sont des biens destinés à être utilisés de manière durable dans l’activité, sans être revendus rapidement. Ils se divisent en immobilisations corporelles (matériel, immeubles), incorporelles (brevets, licences) et financières (titres de participation, prêts). Leur amortissement répartit leur coût sur leur durée d’usage.
Actionnaire : Un actionnaire est une personne physique ou morale détentrice de parts dans une société par actions. Il participe à la vie de l’entreprise via les assemblées générales, reçoit des dividendes et bénéficie d’une part du patrimoine en cas de liquidation. Sa responsabilité est limitée à son apport.
Activité de nature civile : Les activités civiles regroupent les professions libérales, agricoles ou artisanales, excluant tout acte de commerce. Elles sont régies par le droit civil et non par le code de commerce. Elles impliquent un régime juridique et fiscal spécifique, souvent plus souple en termes d’obligations comptables.
Activité de nature commerciale : Une activité commerciale implique l’exercice d’actes de commerce (achat-revente, intermédiaire, production, transport…). Elle relève du droit commercial, avec des obligations spécifiques comme l’immatriculation au registre du commerce, la tenue d’une comptabilité commerciale et l’application des règles du Code de commerce.
Actualisation : L’actualisation est une méthode d’évaluation consistant à convertir des flux futurs en valeur présente en appliquant un taux d’actualisation. Elle permet de comparer des projets d’investissement ou de calculer la valeur actuelle nette (VAN) et ainsi déterminer la rentabilité d’une opération dans le temps.
Amortissement : L’amortissement comptabilise la perte de valeur d’un actif immobilisé sur sa durée d’utilisation. Il traduit une consommation progressive de l’actif dans l’activité de l’entreprise. Cette écriture est non décaissable mais réduit le résultat imposable. Plusieurs méthodes existent : linéaire, dégressif, ou selon l’usage.
Amortissement dégressif : Cette méthode permet une déduction accélérée de la valeur d’un bien en comptabilisant des charges d’amortissement plus élevées en début de vie. Cela reflète souvent une obsolescence rapide. Elle est fiscalement avantageuse pour les entreprises ayant un besoin de réduction de leur résultat imposable à court terme.
Amortissement linéaire : L’amortissement linéaire répartit de manière constante la valeur d’un actif sur sa durée de vie utile. Chaque exercice comptabilise une charge équivalente. Cette méthode, la plus couramment utilisée, convient aux biens dont l’utilisation est stable dans le temps et permet une visibilité sur les charges futures.
Analyse financière : L’analyse financière évalue la santé d’une entreprise à travers l’étude de ses états financiers. Elle examine sa rentabilité, sa structure de financement, sa solvabilité et sa capacité à générer du cash. Elle sert aux dirigeants, investisseurs et prêteurs pour orienter les décisions stratégiques et financières.
Annuité de remboursement des dettes financières : Elle représente la somme annuelle à verser pour rembourser un emprunt, incluant capital et intérêts. L’annuité peut être constante ou variable selon les modalités du contrat. Elle impacte directement la trésorerie de l’entreprise et doit être intégrée dans l’évaluation de sa capacité d’endettement.
Apport : L’apport constitue la contribution d’un associé ou actionnaire à une société. Il peut être réalisé en numéraire (argent), en nature (biens) ou en industrie (compétences). En échange, il confère des droits sociaux et détermine la part de capital détenue, influençant les droits financiers et décisionnels.
Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : L’AGO est une réunion annuelle obligatoire des associés ou actionnaires pour approuver les comptes, décider de l’affectation du résultat et examiner la gestion. Elle est encadrée par la loi et constitue un moment clé dans la gouvernance d’une entreprise, garantissant la transparence et l’information.
Associé : Un associé détient une part du capital social d’une société et participe à sa gestion selon les statuts. Il a droit aux bénéfices (dividendes) et à l’information financière. Dans les sociétés de personnes, sa responsabilité peut être étendue. Il exerce son pouvoir lors des assemblées.
Autofinancement : L’autofinancement désigne la capacité de l’entreprise à investir grâce à ses ressources propres, issues des bénéfices non distribués. Il renforce son indépendance financière, limite le recours à la dette et améliore sa solvabilité. C’est un indicateur clé de la solidité financière et de la rentabilité opérationnelle.
Autonomie financière (Ratio de) : Ce ratio mesure la proportion des capitaux propres dans le financement global de l’entreprise. Il permet d’évaluer la dépendance aux financements extérieurs. Un ratio élevé indique une bonne autonomie financière et une solidité vis-à-vis des créanciers, ce qui rassure investisseurs et banques.
Autoressource : Terme parfois utilisé pour désigner les ressources propres d’une entreprise, comme le résultat net ou la capacité d’autofinancement. Ces ressources permettent à l’entreprise de couvrir ses investissements ou son exploitation sans recourir à des sources externes. Elles sont essentielles à la pérennité financière.
Autres charges externes : Ces charges regroupent les dépenses liées au fonctionnement de l’entreprise hors production directe : sous-traitance, entretien, assurances, frais de déplacement, etc. Elles figurent au compte de résultat et reflètent l’importance des prestations et services utilisés. Leur maîtrise est essentielle à la rentabilité.
Balance : La balance comptable est un tableau récapitulatif listant tous les comptes utilisés par l’entreprise avec leur solde débiteur ou créditeur. Elle permet de vérifier l’équilibre des écritures et sert de base à l’établissement des états financiers, notamment le bilan et le compte de résultat. C’est un outil central de contrôle.
Banque : Une banque est un établissement financier qui gère les comptes courants des entreprises, propose des services de paiement, de crédit et de placement. En comptabilité, les opérations bancaires sont enregistrées dans les comptes de trésorerie et influencent directement la liquidité de l’entreprise. Elle est un partenaire clé pour le financement.
Base amortissable : La base amortissable est la valeur d’un actif à répartir sur sa durée d’utilisation. Elle est généralement égale au prix d’acquisition diminué de la valeur résiduelle estimée. Cette base détermine le montant annuel de l’amortissement, influençant le résultat comptable de l’entreprise sur plusieurs exercices.
Bénéfice : Le bénéfice est le solde positif résultant de l’activité d’une entreprise sur une période donnée, calculé comme la différence entre les produits et les charges. Il peut être affecté à l’autofinancement, distribué en dividendes ou mis en réserve. Il constitue un indicateur central de performance économique.
Bénéfice comptable : Le bénéfice comptable est le résultat net avant impôt tel qu’il ressort des comptes. Il inclut les produits et charges d’exploitation, financiers et exceptionnels. Il ne tient pas compte des retraitements fiscaux. C’est la première mesure de performance financière disponible à la clôture d’un exercice.
Bénéfice fiscal : Le bénéfice fiscal est la base de calcul de l’impôt sur les sociétés. Il est déterminé à partir du bénéfice comptable, après retraitement des éléments non déductibles ou non imposables. Ce résultat est encadré par la réglementation fiscale et peut différer significativement du résultat comptable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) : Le BFR mesure les ressources nécessaires à l’entreprise pour financer son cycle d’exploitation, en comparant les actifs et les passifs à court terme. Un BFR élevé indique que l’entreprise doit mobiliser plus de trésorerie pour fonctionner. Son pilotage est crucial pour éviter les tensions de trésorerie.
BFR négatif : Un BFR négatif signifie que l’entreprise dispose de ressources d’exploitation supérieures à ses besoins, ce qui améliore sa trésorerie. Cela peut être le cas des sociétés encaissant avant de livrer. Ce positionnement confère une marge de sécurité financière appréciable, mais doit être analysé en lien avec l’activité.
BFRE (d’exploitation) : Le besoin en fonds de roulement d’exploitation correspond à la partie du BFR directement liée à l’activité (stocks, créances, dettes fournisseurs). Il exclut les éléments exceptionnels. Une bonne gestion du BFRE permet d’optimiser les flux opérationnels et de préserver la santé financière de l’entreprise.
BFRHE (hors exploitation) : Le BFR hors exploitation est constitué d’éléments exceptionnels ou non récurrents (créances fiscales, charges exceptionnelles). Il peut varier fortement d’un exercice à l’autre. Il est utile pour isoler les éléments non directement liés à l’exploitation courante dans l’analyse de la structure financière.
Bien : Un bien est un élément économique, matériel ou immatériel, susceptible d’être possédé, utilisé ou échangé. Dans l’entreprise, il peut s’agir de biens de production, de vente ou d’investissement. Les biens sont au cœur de l’activité productive et de la valorisation du patrimoine.
Bien d’équipement : Un bien d’équipement est un actif immobilisé utilisé durablement dans le processus de production. Il s’agit de machines, outils, véhicules, bâtiments industriels, etc. Ces investissements sont amortis sur plusieurs années. Ils représentent un levier de productivité et un indicateur de la politique industrielle de l’entreprise.
Bilan : Le bilan est un document de synthèse qui présente à un instant donné l’état du patrimoine de l’entreprise : à l’actif ce qu’elle possède, au passif ce qu’elle doit. Il reflète la structure financière, la solvabilité et l’équilibre entre emplois et ressources. Il est obligatoire en fin d’exercice.
Business angel : Un business angel est un investisseur privé qui apporte des fonds propres à une start-up en phase de création ou de développement. Il s’implique souvent dans la gouvernance et offre un accompagnement stratégique. Il prend un risque important en échange d’un potentiel de plus-value à moyen terme.
Business model : Le business model décrit la manière dont une entreprise crée, délivre et capture de la valeur. Il précise l’offre, la clientèle cible, les canaux de distribution, les ressources clés, les partenaires, les coûts et les sources de revenus. Il constitue un socle stratégique pour le pilotage de l’activité.
Business plan : Le business plan est un document de projection synthétisant la stratégie, les objectifs, les prévisions financières et les besoins en financement d’une entreprise. Il sert à convaincre investisseurs, banques ou partenaires. Il contient généralement une étude de marché, un plan d’action, un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement.
Capacité d’autofinancement (CAF) : La CAF mesure les ressources internes générées par l’activité, capables de financer les investissements et le remboursement des dettes. Elle se calcule à partir du résultat net, en réintégrant les charges non décaissables (amortissements, provisions). Elle est un indicateur clé de rentabilité et d’indépendance financière.
Capacité de remboursement : Ce ratio évalue la faculté de l’entreprise à rembourser ses dettes financières grâce à ses flux de trésorerie. Il est exprimé en nombre d’années. Plus il est faible, meilleure est la solvabilité. Il est scruté par les prêteurs et les analystes dans l’appréciation du risque de crédit.
Capital éclaté : Un capital éclaté est un capital social détenu par une multiplicité d’actionnaires sans qu’aucun ne détienne une majorité de contrôle. Cela peut limiter la prise de décisions stratégiques, rendre l’entreprise vulnérable à des OPA et accroître les tensions en assemblée générale.
Capital social : Le capital social représente l’ensemble des apports réalisés par les associés lors de la création ou de l’augmentation du capital d’une société. Il constitue une ressource stable et figure au passif du bilan. Il garantit les créanciers et détermine les droits des associés.
Capitaux permanents : Les capitaux permanents regroupent les capitaux propres et les dettes à moyen et long terme. Ils financent les investissements durables de l’entreprise. Leur analyse permet d’apprécier la stabilité du financement, l’équilibre financier global et la couverture des immobilisations.
Capitaux propres : Les capitaux propres sont les ressources propres de l’entreprise, issues des apports initiaux, des résultats non distribués et des réserves. Ils représentent la valeur nette de l’entreprise pour les actionnaires. Un niveau élevé de capitaux propres renforce la solidité financière et la capacité d’investissement.
Caution personnelle : La caution personnelle est un engagement pris par une personne physique de rembourser une dette d’entreprise en cas de défaillance de cette dernière. Très fréquente dans les prêts bancaires aux petites entreprises, elle engage le patrimoine personnel du dirigeant cautionnaire et accroît les risques.
Charges : Les charges sont les consommations de ressources nécessaires à l’activité de l’entreprise. Elles peuvent être d’exploitation (achats, salaires), financières (intérêts) ou exceptionnelles (sinistres). Elles diminuent le résultat et doivent être maîtrisées pour assurer la rentabilité. Elles figurent au compte de résultat.
Charges calculées : Les charges calculées sont des charges comptables sans sortie de trésorerie immédiate. Elles incluent notamment les dotations aux amortissements ou aux provisions. Leur objectif est de refléter fidèlement la consommation des actifs ou les risques futurs dans les comptes. Elles impactent le résultat mais non la trésorerie.
Charges d’exploitation : Ce sont toutes les charges liées à l’activité normale et courante de l’entreprise : achats, salaires, loyers, impôts, etc. Elles sont enregistrées dans le compte de résultat. Leur suivi permet d’évaluer la performance opérationnelle. Réduire les charges d’exploitation est un levier classique d’amélioration de la rentabilité.
Charges de personnel : Elles comprennent les salaires bruts, les charges sociales et fiscales afférentes, ainsi que les avantages en nature. Ces charges représentent souvent un poste important pour l’entreprise et doivent être maîtrisées. Elles ont un impact direct sur le résultat et reflètent aussi la politique sociale de l’entreprise.
Charges exceptionnelles : Ces charges correspondent à des événements inhabituels, non récurrents et distincts de l’activité normale, comme une amende, une perte liée à un sinistre ou des restructurations. Elles sont isolées dans les comptes pour ne pas biaiser l’analyse de la performance récurrente de l’entreprise.
Charges financières : Les charges financières regroupent les intérêts sur emprunts, les pertes de change, les dépréciations d’actifs financiers et les autres coûts liés au financement. Elles figurent dans le compte de résultat et influencent directement le résultat net. Une entreprise trop endettée peut voir ses charges financières peser lourdement.
Charges salariales : Les charges salariales sont l’ensemble des contributions sociales et fiscales supportées par l’entreprise en lien avec les rémunérations. Elles incluent les cotisations patronales et les prélèvements sur les salaires. Elles constituent un coût du travail important à prendre en compte dans la gestion des ressources humaines.
Chiffre d’affaires (CA) : Le chiffre d’affaires correspond au total des ventes de biens ou de services réalisées par une entreprise sur une période donnée. Il mesure l’activité commerciale et constitue la principale source de revenus. Le CA est un indicateur fondamental suivi de près pour évaluer la dynamique de croissance.
Coefficient d’actualisation : Le coefficient d’actualisation permet de convertir une valeur future en valeur actuelle. Il dépend du taux d’actualisation et de la durée. Il est utilisé dans les analyses financières pour évaluer la rentabilité des investissements (VAN, TRI) et la pertinence des projets à long terme.
Commissaire aux comptes (CAC) : Le commissaire aux comptes est un auditeur indépendant chargé de certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels. Il vérifie les procédures, la cohérence des états financiers et alerte sur toute anomalie. Sa présence est obligatoire pour les sociétés dépassant certains seuils légaux.
Comptabilité : La comptabilité est un système d’enregistrement des opérations financières d’une entreprise. Elle permet de suivre l’activité, d’établir les comptes annuels, d’informer les parties prenantes et de satisfaire aux obligations légales. Elle est organisée autour du plan comptable et suit des règles précises de classement et de présentation.
Compte : Un compte est une unité de classement des flux comptables. Chaque opération financière est enregistrée dans un ou plusieurs comptes selon sa nature (produit, charge, actif, passif). L’ensemble des comptes constitue le plan comptable. Le solde d’un compte reflète sa situation à un moment donné.
Compte courant d’associé : Il s’agit d’un prêt à court terme consenti par un associé à la société, souvent utilisé pour financer l’exploitation. Il génère une dette de l’entreprise envers l’associé et peut être rémunéré. Il est remboursable sur demande ou selon les clauses définies dans les statuts ou une convention.
Compte de résultat : Le compte de résultat présente l’ensemble des produits et des charges de l’entreprise sur une période donnée. Il permet de déterminer le résultat net de l’exercice (bénéfice ou perte). Il est structuré par grandes catégories : exploitation, financier, exceptionnel, avant impôt et après impôt.
Concours bancaire courant : Ce sont les facilités de trésorerie accordées à court terme par les banques : découvert autorisé, ligne de crédit, escompte, etc. Ils permettent de couvrir les besoins de financement ponctuels. Ils figurent au passif du bilan, parmi les dettes financières à court terme.
Consolidation : La consolidation regroupe les comptes de plusieurs sociétés d’un même groupe pour présenter une image unifiée. Elle élimine les opérations internes et permet d’analyser la situation financière globale. Elle est obligatoire pour les groupes dépassant certains seuils et suit des normes spécifiques (IFRS ou françaises).
Contrat de location : Un contrat de location donne à une entreprise le droit d’utiliser un bien contre paiement d’un loyer. Il peut être simple (location classique) ou avec option d’achat (leasing). Les implications comptables varient selon le type de contrat, notamment avec les normes IFRS qui imposent leur inscription au bilan.
Contrat de location simple : Il s’agit d’un contrat où le loueur conserve la propriété du bien, tandis que le locataire paie un loyer pour l’usage temporaire. Aucun transfert de risque ni d’avantage économique n’est opéré. En comptabilité, les loyers sont enregistrés en charges d’exploitation.
Contrat de location-financement : Ce contrat, souvent appelé leasing, transfère au locataire les risques et avantages liés au bien loué. Il est assimilé à un achat à crédit et implique une comptabilisation à l’actif, avec en contrepartie une dette au passif. Il est courant pour les véhicules ou matériels professionnels.
Court terme : En finance et comptabilité, le court terme désigne une échéance inférieure à 12 mois. Cela concerne les actifs et passifs liquides ou exigibles rapidement, comme les créances clients ou les dettes fournisseurs. La gestion du court terme est cruciale pour assurer la solvabilité immédiate.
Coût de la dette : Le coût de la dette est le taux moyen d’intérêt payé sur les emprunts. Il peut être brut ou net d’impôt. Un bon pilotage du coût de la dette permet d’optimiser la structure financière et de maximiser la rentabilité des capitaux propres grâce à l’effet de levier.
Coût moyen pondéré du capital (CMPC) : Le CMPC est un taux représentant le coût global du financement d’une entreprise, en prenant en compte la part du capital propre et de la dette. Il est utilisé comme taux d’actualisation dans les projets d’investissement. Il reflète le rendement exigé par les investisseurs et créanciers.
Créance : Une créance est un droit de recevoir un paiement de la part d’un tiers. Elle est inscrite à l’actif du bilan et peut concerner des clients, l’administration fiscale ou d’autres débiteurs. Sa gestion est essentielle pour préserver la trésorerie et réduire le risque d’impayé.
Créance client : Il s’agit d’un montant dû par un client à l’entreprise à la suite d’une vente. Elle est inscrite à l’actif et représente une part importante de la liquidité future. Le suivi des délais de règlement et le recouvrement sont des enjeux de gestion cruciaux.
Créance d’exploitation : Les créances d’exploitation regroupent les sommes dues dans le cadre de l’activité normale : ventes à crédit, TVA récupérable, etc. Elles sont distinguées des créances financières ou exceptionnelles. Leur rotation rapide est souhaitable pour assurer un bon cycle de trésorerie.
Création de valeur : La création de valeur mesure l’aptitude d’une entreprise à générer un rendement supérieur au coût de ses ressources. Elle repose sur la rentabilité économique, l’innovation, l’optimisation des coûts et la qualité du management. C’est un objectif clé pour les actionnaires et la stratégie à long terme.
Crédit : Le crédit est une avance de fonds consentie par un prêteur à une entreprise, remboursable avec intérêts. Il peut être bancaire, obligataire ou commercial. Il constitue une source de financement externe permettant d’investir ou de couvrir les besoins de trésorerie à condition d’en maîtriser le coût.
Crédit de TVA : Ce crédit résulte d’un excès de TVA déductible sur les achats par rapport à la TVA collectée sur les ventes. Il peut être reporté ou remboursé par l’administration fiscale. Il est inscrit à l’actif du bilan et améliore la trésorerie à court terme.
Crédit-bail : Le crédit-bail permet à une entreprise de louer un bien (souvent un équipement) avec une option d’achat en fin de contrat. Il combine les avantages de la location (flexibilité) et ceux de la propriété différée. Il est comptabilisé en immobilisation avec une dette correspondante dans certains cas.
Cycle d’exploitation : Le cycle d’exploitation comprend l’ensemble des opérations liées à l’activité : approvisionnement, production, commercialisation et encaissement. Sa durée influence le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Un cycle court permet une meilleure rotation du capital et une moindre dépendance au financement externe.
Décaissement : Un décaissement est une sortie effective de trésorerie. Il concerne le paiement de fournisseurs, de salaires, de dettes financières ou d’impôts. Il est enregistré dans les flux de trésorerie et doit être anticipé pour éviter les tensions de liquidité.
Délai de récupération (Payback) : Ce délai mesure le temps nécessaire pour que les flux nets générés par un investissement égalent le montant investi. C’est un indicateur de rentabilité simple, utilisé pour évaluer les projets. Plus le délai est court, plus l’investissement est jugé sûr.
Dette : La dette représente une obligation financière contractée par l’entreprise envers des tiers, tels que des fournisseurs, des établissements bancaires ou l’administration fiscale. Elle figure au passif du bilan et traduit l’engagement de l’entreprise à rembourser des montants dus selon des conditions convenues.
Dette d’exploitation : Il s’agit des dettes issues de l’activité courante de l’entreprise. Elles incluent principalement les montants dus aux fournisseurs, les charges sociales ou fiscales non encore payées. Ces dettes sont généralement à court terme et directement liées au fonctionnement quotidien de l’entité.
Dette financière : Cette catégorie regroupe les sommes empruntées auprès d’institutions financières ou par émission obligataire. Elles sont assorties d’intérêts et remboursables à moyen ou long terme. La dette financière reflète la politique de financement externe de l’entreprise et influence sa structure de capital.
Dette fournisseur : La dette fournisseur correspond aux achats de biens ou services réalisés par l’entreprise et non encore réglés. Elle constitue un passif à court terme et est utilisée pour évaluer le crédit fournisseur, soit le délai moyen de paiement accordé par les fournisseurs.
Dirigeant : Le dirigeant est la personne physique ou morale légalement habilitée à représenter, administrer et engager la société. Il peut être gérant, président ou administrateur selon la forme juridique de l’entreprise. Il est responsable de la gestion stratégique et opérationnelle de l’organisation.
Disponibilité : Les disponibilités désignent les liquidités immédiatement accessibles par l’entreprise. Elles incluent les soldes de caisse et de comptes bancaires. Ces ressources financières permettent de faire face aux engagements immédiats et constituent un indicateur clé de la trésorerie disponible.
Dividende : Le dividende est une part du bénéfice distribuée aux actionnaires. Son versement est décidé en assemblée générale et proportionnel à la détention du capital. Il constitue une rémunération du risque pris par les actionnaires et reflète la performance financière de l’entreprise.
Dotation aux amortissements : Cette écriture comptable traduit la perte de valeur d’un actif immobilisé liée à son usage ou à son obsolescence. Elle est étalée sur la durée d’utilisation de l’actif et permet d’ajuster sa valeur comptable tout en respectant le principe de prudence.
Dotation aux provisions pour dépréciation : Cette écriture comptable permet d’anticiper une baisse de valeur probable mais non définitive d’un actif. Elle reflète un risque identifié, comme une créance douteuse, et permet d’ajuster la valeur comptable de l’actif tout en respectant les principes de prudence et de sincérité des comptes.
Durée d’utilité : Il s’agit de la période pendant laquelle un actif immobilisé est censé générer des avantages économiques pour l’entreprise. Cette estimation est essentielle pour déterminer la durée d’amortissement applicable à l’actif concerné. Elle repose sur des critères techniques, économiques ou contractuels.
EBE (Excédent Brut d’Exploitation) : L’EBE représente la richesse générée par l’activité de l’entreprise, avant les dotations aux amortissements, les charges financières et les impôts. Il constitue un indicateur clé de la performance opérationnelle et de la rentabilité brute du modèle économique sans tenir compte de la structure financière.
EBITDA : L’EBITDA, ou excédent brut d’exploitation avant amortissements, intérêts et impôts, mesure la performance opérationnelle d’une entreprise sans tenir compte de sa politique d’investissement ou de financement. Cet indicateur est très utilisé pour évaluer la rentabilité brute et la capacité de génération de cash.
EENE : L’effet escompté non échu est un effet de commerce déjà remis à une banque pour escompte, mais dont la date d’échéance n’est pas encore atteinte. Il figure parmi les engagements hors bilan, car l’entreprise reste responsable en cas de non-paiement à l’échéance.
Effet de levier financier : Ce mécanisme vise à augmenter la rentabilité des capitaux propres en recourant à l’endettement. Lorsque la rentabilité économique de l’entreprise dépasse le coût de la dette, le levier amplifie les gains des actionnaires. À l’inverse, un effet de levier mal maîtrisé peut accroître les pertes.
Effets de commerce : Ce sont des titres représentatifs d’une créance commerciale, comme les lettres de change ou les billets à ordre. Utilisés comme instruments de paiement ou de financement, ils facilitent le recouvrement de créances à échéance et peuvent être escomptés auprès d’une banque.
Emploi circulant : Les emplois circulants désignent les actifs à court terme intervenant dans le cycle d’exploitation, tels que les stocks, les créances clients et la trésorerie. Contrairement aux immobilisations, ces éléments sont en perpétuelle rotation et participent directement au fonctionnement opérationnel de l’entreprise.
Emprunt : Un emprunt est une dette contractée par l’entreprise auprès d’un établissement financier, remboursable sur une durée déterminée avec intérêts. Il permet de financer des investissements ou d’assurer la trésorerie, en contrepartie d’un coût du capital et d’un engagement de remboursement structuré.
Encaissement : L’encaissement correspond à une entrée d’argent dans l’entreprise, qu’elle provienne d’une vente, d’un règlement client ou d’un financement externe. Il s’agit d’un flux positif de trésorerie qui améliore la liquidité et reflète le bon fonctionnement du recouvrement et des circuits financiers.
Endettement net : Cet indicateur mesure l’endettement financier réel de l’entreprise, en soustrayant les disponibilités de ses dettes financières. Il reflète la capacité de remboursement à court et moyen terme, et sert de critère d’évaluation de la solidité financière et de la dépendance aux financements extérieurs.
Entité mère : L’entité mère est une société qui détient une participation majoritaire dans une ou plusieurs autres sociétés, appelées filiales. Elle exerce un contrôle sur leur stratégie et leur gestion, et consolide leurs comptes dans le cadre d’un groupe selon les normes comptables applicables.
Escompte : L’escompte est une opération de financement à court terme par laquelle une entreprise cède une créance commerciale à une banque avant son échéance, moyennant un coût (intérêts et commissions). Cette technique permet d’améliorer la trésorerie sans attendre le règlement client.
EURL : L’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée est une forme de SARL ne comportant qu’un seul associé. Elle permet de concilier gestion simplifiée et responsabilité limitée au montant des apports. L’associé unique peut opter pour l’imposition à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés.
Exercice : Un exercice comptable correspond à une période de référence (souvent de 12 mois) au cours de laquelle l’entreprise mesure ses résultats financiers. À l’issue de l’exercice, les comptes sont arrêtés, les bilans établis et les résultats analysés pour prise de décision et obligations fiscales.
Experts-comptables en ligne : Ces plateformes proposent des services comptables dématérialisés aux entreprises via internet. Elles permettent de centraliser la comptabilité, les déclarations fiscales et sociales, et d’accéder à un accompagnement professionnel à distance. Elles offrent flexibilité, gain de temps et réduction des coûts pour les TPE/PME tout en assurant la conformité légale.
Faute de gestion : La faute de gestion résulte d’un comportement inadapté, négligent ou abusif du dirigeant dans l’administration de la société. Si elle cause un préjudice à l’entreprise ou à ses créanciers, elle peut engager la responsabilité civile voire pénale du dirigeant, notamment en cas de redressement judiciaire.
FCP (Fonds Commun de Placement) : Un FCP est un organisme de placement collectif permettant à des investisseurs de détenir collectivement un portefeuille de valeurs mobilières. Il est géré par une société de gestion agréée. Le FCP n’a pas de personnalité morale mais fonctionne comme une copropriété de titres.
Filiale : Une filiale est une société contrôlée majoritairement par une autre entreprise, appelée maison mère. Cette dernière détient plus de 50 % de son capital et peut influer sur ses décisions stratégiques et financières. Les filiales peuvent être consolidées dans les comptes du groupe.
Flux de trésorerie : Les flux de trésorerie, ou cash flows, retracent toutes les entrées et sorties d’argent effectives. Ils permettent de suivre la capacité d’une entreprise à financer ses opérations, ses investissements et à rembourser ses dettes. Une gestion rigoureuse de ces flux garantit la stabilité financière.
Fonds de roulement (FDR) : Le fonds de roulement correspond à l’excédent des ressources durables (capitaux propres et dettes à long terme) sur les emplois durables (immobilisations). Il permet de financer le cycle d’exploitation et garantit la stabilité financière de l’entreprise face à ses besoins à court terme.
Fonds propres : Les fonds propres, ou capitaux propres, représentent les ressources stables appartenant aux actionnaires de l’entreprise. Ils incluent le capital social, les réserves et le résultat non distribué. Ils servent à financer l’activité et à absorber les pertes éventuelles, assurant la pérennité.
Frais d’établissement : Il s’agit des dépenses engagées lors de la constitution ou du développement de l’entreprise (frais de constitution, publicité légale, honoraires). Selon leur nature et les règles comptables, ces frais peuvent être activés à l’actif ou comptabilisés en charges sur l’exercice.
Frais de R&D : Les frais de recherche et développement désignent les dépenses engagées dans la conception de nouveaux produits ou procédés. Selon les normes comptables, ils peuvent être comptabilisés en charges ou inscrits à l’actif s’ils remplissent certains critères de valorisation et d’utilité future.
Free Cash Flow : Le free cash flow représente la trésorerie nette générée par l’entreprise après déduction des investissements nécessaires au maintien ou au développement de son activité. Il peut être utilisé pour rémunérer les actionnaires, rembourser la dette ou être réinvesti. Il reflète la solidité financière de l’entreprise.
Grand livre des comptes : Le grand livre est un registre comptable où sont reportées l’ensemble des écritures ventilées par comptes (clients, fournisseurs, banque…). Il permet de suivre l’historique détaillé de chaque compte et constitue une base essentielle pour établir les états financiers de fin d’exercice.
Haut de bilan : Le haut de bilan regroupe les éléments stables du passif (capitaux propres, dettes financières à long terme) et les actifs immobilisés. Il reflète la structure financière de long terme de l’entreprise, son capital investi, et les ressources mobilisées pour financer les immobilisations.
Holding : Une holding est une société dont l’objet principal est de détenir des participations dans d’autres entreprises. Elle peut avoir une fonction purement financière ou jouer un rôle actif dans la stratégie du groupe. Elle permet aussi des optimisations fiscales ou patrimoniales.
IFRS : Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont des normes comptables internationales qui visent à harmoniser la présentation des états financiers. Elles reposent sur une approche économique plutôt que juridique. Obligatoires pour les groupes cotés en Europe, elles favorisent la comparabilité des comptes.
Illicite : Est considéré comme illicite tout acte, contrat ou comportement contraire à la législation en vigueur. Cela peut entraîner sa nullité juridique, des sanctions civiles ou pénales. En droit des affaires, cela concerne notamment les pratiques anticoncurrentielles, les fraudes ou la corruption.
Immobilisation : Les immobilisations regroupent les biens durables acquis ou produits par l’entreprise pour son activité (corporelles, incorporelles ou financières). Elles sont inscrites à l’actif du bilan et amorties selon leur durée d’utilisation. Elles se distinguent des charges de l’exercice.
Immobilisation corporelle : Il s’agit d’un bien matériel utilisé durablement dans l’activité de l’entreprise, comme un terrain, un bâtiment, du matériel industriel ou du mobilier. Ces actifs sont amortis sur leur durée d’utilité, sauf pour les terrains, non amortissables car non sujets à dépréciation.
Immobilisation financière : Ces immobilisations comprennent les participations dans d’autres sociétés, les prêts à long terme ou les dépôts de garantie. Elles sont destinées à être conservées durablement et figurent à l’actif du bilan. Elles traduisent une stratégie de placement ou de contrôle.
Immobilisation incorporelle : Les immobilisations incorporelles sont des actifs immatériels comme les brevets, logiciels, marques ou fonds de commerce. Elles génèrent des avantages économiques futurs pour l’entreprise. Leur valorisation et leur amortissement obéissent à des règles spécifiques, souvent complexes à évaluer.
Impôt différé : L’impôt différé correspond à une charge ou une économie d’impôt qui se manifestera dans le futur en raison d’écarts temporaires entre résultat comptable et fiscal. Il permet de lisser les effets fiscaux sur plusieurs exercices. Il est inscrit au bilan, en actif ou en passif.
Impôt sur le revenu (IR) : L’IR est un impôt progressif payé par les personnes physiques sur leurs revenus (salaires, bénéfices, pensions…). Certaines entreprises, comme les EURL ou les sociétés de personnes, peuvent être soumises à cet impôt si elles n’optent pas pour l’impôt sur les sociétés.
Impôt sur les sociétés (IS) : L’IS est un impôt prélevé sur les bénéfices réalisés par les sociétés. Il se base sur le résultat fiscal, qui peut différer du résultat comptable. Les taux peuvent varier selon le montant du bénéfice ou la taille de l’entreprise. C’est un impôt direct.
Indicateurs de pilotage : Ces indicateurs servent à suivre la performance globale de l’entreprise dans ses dimensions économique, opérationnelle, humaine ou environnementale. Ils sont indispensables au contrôle de gestion et à l’aide à la décision. Exemples : taux de marge, productivité, turnover, taux de satisfaction client.
Intensité capitalistique : Ce ratio mesure le montant de capitaux investis nécessaire pour générer un euro de chiffre d’affaires. Il renseigne sur la lourdeur de l’outil de production et sur le besoin en financement. Une forte intensité traduit une activité industrielle ; une faible, un secteur de service.
Investissement : Un investissement est une dépense engagée par l’entreprise pour acquérir ou améliorer un actif dans le but d’en tirer un avantage futur. Il peut être matériel, immatériel ou financier. L’investissement est souvent analysé en termes de rentabilité, de durée d’amortissement et de risque.
Juste valeur : La juste valeur désigne le prix auquel un actif ou un passif pourrait être échangé entre deux parties informées et consentantes dans une transaction normale. Elle reflète la valeur de marché et non la valeur historique. C’est une base d’évaluation utilisée dans les normes IFRS.
Licéité : La licéité désigne le caractère conforme à la loi d’un acte juridique, d’un contrat ou d’une opération. Un acte illicite peut être annulé, voire sanctionné. La licéité est une condition indispensable à la validité d’un contrat selon le droit civil et commercial.
Liquidité : La liquidité mesure la capacité d’une entreprise à faire face à ses dettes à court terme grâce à ses ressources disponibles. Elle reflète la solvabilité immédiate et repose sur la trésorerie, les créances rapidement recouvrables et les actifs facilement mobilisables.
Liquidité du bilan : Ce concept désigne l’aptitude des actifs de l’entreprise à être transformés en liquidités à court terme, en lien avec l’échéance des passifs. Un bilan équilibré sur le plan de la liquidité garantit que les dettes exigibles à court terme pourront être honorées.
Logiciels de comptabilité : Ces logiciels permettent d’automatiser l’enregistrement des opérations comptables, la production des états financiers et les déclarations fiscales. Ils simplifient la gestion quotidienne des entreprises, assurent la conformité réglementaire et facilitent le pilotage grâce à des tableaux de bord et des rapports de gestion adaptés à chaque activité.
Logiciels de gestion des finances personnelles : Ces outils sont conçus pour aider les particuliers à suivre leurs dépenses, établir un budget, planifier leur épargne ou analyser leurs habitudes financières. Ils permettent une meilleure visibilité sur les flux financiers individuels ou familiaux, favorisent la maîtrise du budget et facilitent la préparation de projets à moyen terme.
Logiciels de notes de frais & dépenses : Ces logiciels permettent de gérer, enregistrer et rembourser les frais professionnels engagés par les salariés. Ils automatisent la saisie des justificatifs, la validation hiérarchique et l’intégration comptable. Ils facilitent la transparence des dépenses, réduisent les erreurs manuelles et accélèrent le traitement des remboursements dans un cadre fiscal conforme.
Logiciels de trésorerie & gestion budgétaire : Ces outils permettent aux entreprises de suivre leurs flux de trésorerie, d’élaborer des prévisions financières et de piloter leur budget. Ils offrent une vision claire de la situation financière, aident à anticiper les besoins de financement et à optimiser les ressources disponibles pour assurer la pérennité économique.
Long terme : Le long terme, en gestion financière, désigne une période supérieure à cinq ans. C’est l’horizon typique des investissements stratégiques, des financements d’infrastructure ou des immobilisations importantes. Il suppose une stabilité économique et un engagement durable des ressources.
Marge brute : La marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires et le coût des marchandises vendues ou des matières premières consommées. Elle mesure la rentabilité immédiate des ventes et permet d’évaluer l’efficacité de la politique d’approvisionnement et de tarification.
Marge commerciale : La marge commerciale est la différence entre le prix de vente des marchandises et leur coût d’achat hors taxes. Elle est utilisée principalement dans les entreprises de négoce. Elle constitue un indicateur clé pour fixer les prix et suivre la rentabilité des ventes.
Marge de production : Elle représente l’excédent entre la valeur de la production réalisée (biens et services) et les consommations de production (matières, énergie, sous-traitance). Elle permet d’apprécier la contribution productive de l’activité industrielle ou artisanale hors charges fixes.
Moyen terme : Le moyen terme correspond à un horizon de gestion ou de financement compris entre un et cinq ans. Il est souvent utilisé pour planifier les projets de développement, financer les investissements productifs ou évaluer la viabilité de projets à durée limitée.
Normes IFRS : Les normes IFRS sont des règles comptables internationales permettant de produire des états financiers reflétant la réalité économique. Elles favorisent la comparabilité, la transparence et l’analyse des comptes consolidés des groupes cotés à l’échelle mondiale. Elles remplacent les référentiels nationaux dans certains cas.
Obligation convertible : Une obligation convertible est un titre de créance qui peut être transformé en actions de la société émettrice selon des conditions prévues. Elle combine le rendement d’un emprunt et la possibilité de profiter d’une hausse du capital. C’est un instrument de financement hybride.
Organisation IASC : L’International Accounting Standards Committee (IASC) est l’organisme précurseur de l’IASB, chargé de l’élaboration des normes comptables internationales. Fondé pour harmoniser les règles comptables à l’échelle mondiale, il a posé les bases des normes IFRS aujourd’hui en vigueur.
Participation des salariés : La participation est un mécanisme de redistribution d’une part des bénéfices aux salariés dans les entreprises de plus de 50 personnes. Elle est obligatoire et calculée selon une formule réglementaire. Elle peut être versée ou placée dans des dispositifs d’épargne salariale.
Passif : Le passif regroupe l’ensemble des ressources dont dispose une entreprise pour financer ses actifs. Il comprend les capitaux propres et les dettes (financières, fournisseurs, fiscales…). Le passif traduit l’origine des financements mobilisés et reflète les engagements de l’entreprise.
Passif courant : Le passif courant comprend les dettes exigibles à court terme (moins d’un an), comme les dettes fournisseurs, fiscales, sociales ou bancaires. Il permet d’évaluer les obligations immédiates de l’entreprise et nécessite un bon suivi de la trésorerie.
Passif d’impôt différé : Ce passif correspond à des charges fiscales futures liées à des écarts temporaires entre résultat comptable et fiscal. Il traduit un engagement à verser un impôt ultérieurement, selon la réversion de ces écarts. Il est reconnu selon les règles fiscales et comptables en vigueur.
Patrimoine : Le patrimoine d’une entreprise ou d’un individu est constitué de l’ensemble de ses actifs. En net, il correspond à la valeur des biens moins l’ensemble des dettes. Il représente la richesse réelle disponible et est un indicateur de solidité financière.
Rentabilité : La rentabilité exprime la capacité d’une entreprise à générer un bénéfice par rapport à ses ressources. Elle peut être économique (résultat d’exploitation sur actifs) ou financière (résultat net sur capitaux propres). Elle est centrale pour évaluer la performance d’un investissement.
Résultat : Le résultat est la différence entre les produits et les charges d’un exercice. Il est positif (bénéfice) ou négatif (perte) et permet de mesurer la performance globale de l’entreprise sur la période. Il sert de base à la distribution de dividendes.
Résultat d’exploitation : Ce solde reflète la performance opérationnelle de l’entreprise hors éléments financiers et exceptionnels. Il est issu de l’activité courante, après déduction des charges d’exploitation. Il permet d’apprécier la rentabilité intrinsèque du modèle économique.
Résultat net : Le résultat net est le bénéfice ou la perte dégagé à la clôture de l’exercice, après intégration de l’ensemble des produits et charges, y compris financiers et exceptionnels, et déduction des impôts. C’est un indicateur central pour les actionnaires et les tiers.
SARL, SA, SAS, SASU, SNC, SCP, SELARL : Ces sigles désignent différentes formes juridiques de sociétés françaises. Chacune implique un mode de fonctionnement, un régime de responsabilité, un régime fiscal et des obligations comptables spécifiques. Le choix dépend de la taille, des objectifs et de la structure de l’activité.
SICAV : Les SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) sont des structures de gestion collective de portefeuille. Elles permettent aux investisseurs d’acquérir des parts d’un fonds diversifié. Gérées par des professionnels, elles offrent une mutualisation des risques et une liquidité encadrée.
Solde d’un compte : Le solde d’un compte comptable correspond à la différence entre le total des débits et le total des crédits. Il peut être débiteur ou créditeur et permet d’évaluer la situation financière d’un poste donné à un moment donné.
Solvabilité : La solvabilité désigne la capacité d’une entreprise à faire face à l’ensemble de ses dettes en cas de liquidation. Elle se mesure par des ratios financiers et constitue un critère clé pour les partenaires financiers, les investisseurs et les créanciers.
Stock : Les stocks regroupent les biens détenus en vue d’être consommés ou vendus : matières premières, marchandises, en-cours de production et produits finis. Ils sont valorisés à l’inventaire et influencent directement le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.
Trésorerie : La trésorerie représente l’ensemble des liquidités disponibles immédiatement (caisse, comptes bancaires). Elle reflète la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements à court terme. Une trésorerie saine est essentielle pour assurer la continuité d’exploitation et éviter les difficultés financières.
TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : La TVA est un impôt indirect sur la consommation, collecté par les entreprises sur leurs ventes de biens ou services et reversé à l’État. Elle est neutre pour les entreprises, qui la déduisent sur leurs achats et la collectent sur leurs ventes.
Valeur actuelle / VAN / VMP / Valeur résiduelle : La valeur actuelle nette (VAN) permet d’évaluer la rentabilité d’un investissement en actualisant les flux futurs. La valeur résiduelle correspond à la valeur estimée d’un actif en fin d’usage. Les VMP sont des titres à court terme. Tous ces outils aident à la décision financière.
Viable : Un projet ou une entreprise est dit viable lorsqu’il peut fonctionner durablement avec un équilibre entre ressources, charges et revenus. La viabilité s’apprécie sur les plans économique, financier et organisationnel, et conditionne la survie à moyen et long terme de l’activité.